01/04/2025
Anxiété et angoisse
(Photo- Nice, la Promenade vers l'aéroport)
En novembre 2020, en pleine épidémie de Covid, CEFRO publiait une note sur les possibles stratégies pour gérer l’incertitude et pour faire face aux nombreuses théories du complot. Deux ans plus tard, la guerre en Ukraine éclatait, la Russie continuant son projet d’expansion commencé en 2014. Le monde s’est vu confronter à un nouveau défi: le conflit armé sur le continent européen a mobilisé les alliances mais a également divisé. L’élection du président Trump pour un second mandat en novembre 2024 a marqué un retournement complet de la situation politique mondiale. L’allié américain d’hier est devenu l’adversaire d’une Europe sidérée, après 80 ans. Nous sommes donc confrontés à une incertitude politique qui génère un stress profond, une anticipation négative générale, un sentiment de danger, d’insécurité et de menace. Notre sentiment d’impuissance est décuplé. Le problème avec l’anxiété politique provoquée par les événements actuels est qu’elle n’est pas qu’une simple crise qui crée une rupture avec l’état antérieur ou un équilibre moins satisfaisant. Non, elle renverse complètement l’ordre des valeurs que nous estimons solides depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans l’anxiété sociale, caractérisée par la peur persistante des situations sociales souvent liée à la crainte d’être jugé ou rejeté par les autres, et des comportements d’évitement, l’antidote serait l’action, se mobiliser pour agir et sortir de la spirale de l’évitement. Dans l’anxiété politique, ce serait le fait d’aller voter (dans nos sociétés démocratiques). Oui, mais voilà, cela n’est plus une garantie.
D'après le journaliste américain Robert D.Kaplan, réputé pour ses analyses géopolitiques, l’instabilité du monde va s’accroître, tout comme à Weimar dans les années 1930, et il craint que la situation ne devienne incontrôlable. "La Russie post-Poutine sera sans doute la première grande puissance à s’effondrer" (L’Express). "Ainsi, au lieu d’une Allemagne fragmentée en Länder interconnectés où une crise dans l’un pouvait rapidement se propager aux autres, nous vivons aujourd'hui dans un monde où chaque pays est lié aux autres de manière si profonde qu’une crise en un seul endroit peut déclencher un effet domino aux conséquences presque universelles", écrit l’auteur. Robert Kaplan rappelle toutefois: "aucun analyste ne peut prévoir avec certitude la situation d’un pays dans plusieurs décennies. Ce qu’un journaliste ou un analyste peut faire, c’est rendre le lecteur moins surpris par ce qui va arriver dans une région donnée sur un horizon de moyen terme".
Fromm dit que la nature de toutes les expériences humaines est inférée dans un système symbolique. L’effort de l’homme consiste à réaliser l’unité en lui-même, unité de pensée, unité d’action et, le plus difficile, l’unité entre la pensée et l’action. C’est cette force qui détermine ses actes (Abélard la nommait intention et la psychanalyse désir) qui va l’exprimer profondément. Le pouvoir de la réflexion est un processus personnel basé sur notre capacité de discernement, mais également sur notre vécu, sur nos expériences. Dans L’Art d’avoir toujours raison, Schopenhauer conclut que ce monde n’est pas peuplé de pensants véritables, car "l’homme est en réalité un pauvre animal semblable aux autres, dont les forces sont calculées en vue du maintien de son existence. Aussi doit-il tenir constamment ouvertes ses oreilles, qui lui annoncent d’elles-mêmes, la nuit comme le jour, l’approche de l’ennemi."
Que pouvons-nous faire quand les choses semblent échapper à notre contrôle ? Il est difficile de vivre dans l’incertitude. Les êtres humains ont besoin d’information sur le futur de la même façon qu’ils ont besoin de nourriture et d’autres récompenses de base. Notre cerveau perçoit l’ambiguïté comme une menace, et il essaie de nous protéger: nous ne sommes plus capables de nous concentrer sur autre chose que sur la construction d’une certitude. Les études montrent que l’incertitude de l’emploi, par exemple, a un impact plus important sur notre santé que la perte de l’emploi. Les fondamentalistes religieux opposent à l’anxiété des règles et des vérités sans ambiguïté. Les théories du complot nous fournissent des explications simples pour des phénomènes complexes.
Mais souvent, peut-être toujours, il est plus efficace de ne pas chercher à créer de la certitude. Bien que notre évolution ait façonné notre cerveau pour résister à l’incertitude, en réalité nous ne savons jamais de quoi l’avenir sera fait. Il faut apprendre à vivre avec l’ambiguïté. "L’incertitude, c’est la seule certitude qui existe", écrit le mathématicien John Allen Paulos. Savoir vivre avec l’insécurité est la seule sécurité. Voici sept stratégies pour gérer l’incertitude : n’opposons pas de résistance (accepter) ; investissons en nous-mêmes ; trouvons des moyens sains pour nous réconforter ; ne croyons pas tout ce que nous pensons ; soyons attentifs ; arrêtons d’attendre quelqu'un pour nous secourir ; trouvons du sens au milieu du chaos.
L’anxiété politique liée à l’incertitude et à l’insécurité nous envoie à quelque chose de plus profond, nos angoisses de mort. Comment faire pour ne pas se laisser dévorer ? Dans un enregistrement sur RTL, Charles Pépin, philosophe et romancier français, partage quelques réflexions sur le sujet.
"Il ne faut pas fuir ces angoisses en pensant qu’ainsi on va s’en débarrasser et il faut surtout éviter de tomber dans le divertissement pascalien. Celui-ci, c’est la manière de fuir la pensée de la mort en se perdant dans les mondanités, l’agitation superficielle, ou même les guerres…Toute action destinée à éviter de penser à la mort qui nous attend, c’est-à-dire à notre humaine condition. Mais ce divertissement est inefficace, car tôt ou tard on sera rattrapé par la pensée de ce que l’on a voulu fuir. C’est un effet boomerang, et l’angoisse est alors plus épaisse encore. On voit aussi les limites du volontarisme ("quand on veut, on peut"). Il ne suffit pas de vouloir ne plus penser à la mort pour le pouvoir. On ne se laisse pas dévorer par l’angoisse, mais on ne nourrit pas non plus l’illusion de s’en débarrasser complètement. Comme dit Pascal, "nous sommes embarqués dans cette existence", et à la fin de cette existence il y a la mort. Et la mort, nous ne savons pas ce que c’est. Nous assistons parfois à la mort des autres, mais la mort des autres ne nous dit rien de notre propre mort. Philosopher, c’est apprendre à mourir, se préparer à mourir, disent tous les philosophes, de Socrate à Montaigne, en passant par les Stoïciens. Mais comment se préparer à quelque chose dont on ignore la véritable nature ? A quoi faut-il se préparer ? Peut-être au fait que nous ne serons pas prêts le jour où la mort viendra. Peut-être que le sage est celui qui est prêt à bien vivre le fait qu’il ne sera pas prêt. Peut-être que la vraie sagesse est de se préparer dans la vie comme dans la mort au fait qu’il y aura toujours une relative impréparation, et qu’il faudra faire avec. Est-ce que cela est censé nous rassurer ?
Oui, finalement, parce que cela revient à dire que notre angoisse de mort est normale. L’idée n’est pas de s’en débarrasser, mais simplement qu’elle ne nous paralyse pas. Apprendre à vivre avec la pensée de la mort. On peut donner des rendez-vous réguliers à cette pensée de la mort, comme nous invitaient les Stoïciens, la fréquenter le plus souvent possible de manière à nous habituer à l’idée comme pour en "user" le caractère angoissant. Grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que lorsqu'on s’habitue à l’idée on la voit autrement, en créant de nouveaux chemins neuronaux à force de revenir, de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Par exemple, au lieu de voir l’idée de la mort simplement négativement, on la voit comme ce qui donne son sel à la vie et comme un mystère qui est finalement plus électrisant qu’angoissant.
Cela marchera toujours mieux que d’éviter d’y penser. Mais si toutefois cela ne suffit pas, alors pensons à la vie. Qu’est-ce qui est important dans ma vie ? Qu’est-ce que je dois avoir fait avant de mourir ? Car si la mort nous angoisse tant, c’est parce qu’elle menace de venir trop tôt et de nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Eh bien, empressons-nous de le faire. Et cette action-là ne sera pas un divertissement pascalien, parce qu’en elle nous l’accomplirons avec l’idée de la mort en tête. Nous vivrons, comme l’écrit Montaigne, "à propos", et la conscience de notre mort nous rendra non pas plus angoissés, mais plus lucides, plus responsables, plus vivants."
N.B. Pour lire ou relire d'autres notes, il suffit d'entrer des mots-clés dans la case Rechercher, colonne à gauche.
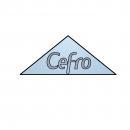






Les commentaires sont fermés.