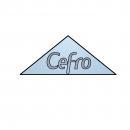15/08/2016
L'(in)adaptation au réel
 (Photo: Greenville, Caroline du Sud)
(Photo: Greenville, Caroline du Sud)
Je vous propose la relecture d'une théorie qui met en rapport les besoins psychologiques essentiels et la responsabilité: la thérapie par le réel (William Glasser), mentionnée aussi dans une note antérieure avec le lien vers une présentation de l'ouvrage en question. Les besoins psychologiques essentiels de l’être humain ne sont pas différents selon les cultures, mais inhérents à la race humaine: aimer et être aimé, et se sentir utile à soi-même et aux autres. Selon le psychiatre américain, la personne qui a besoin d'un traitement psychiatrique souffre d'abord et avant tout d'inadaptation et cela quelle que soit la façon dont elle exprime son problème (psychose, troubles du comportement, dépression, etc.). L'inadaptation signifie que le patient est incapable de satisfaire ses besoins essentiels. Plus l'individu sera incapable de satisfaire ses besoins à un degré élevé, et plus la sévérité des symptômes sera grande. Alors, comment vivent les personnes les plus adaptées, celles qui arrivent à satisfaire leurs besoins dans la société? Pour répondre à cette question le Dr. Glasser suggère qu'à tout moment de notre vie nous devons être lié à au moins une personne qui peut elle-même satisfaire ses besoins de façon adéquate. Sans cette personne clé qui nous aide à supporter le quotidien de la vie et nous donne le courage de continuer notre route, nous commençons à satisfaire nos besoins de façon irréaliste. Ceci peut entraîner l'éclosion de symptômes anxieux et aller jusqu'au refus complet de la réalité. (…) "Les gens n'agissent pas de façon irresponsable parce qu'ils sont malades; ils sont malades parce qu'ils agissent de façon irresponsable".
Dans l'approche analytique, les conflits mentaux inconscients sont plus importants que les problèmes conscients. Il est important de les faire connaître au malade à l'aide de l'interprétation des rêves, du transfert et d'associations libres, mais en même temps il est nécessaire d'éveiller la responsabilité du patient, et ne pas le laisser se livrer en excusant son comportement sur la base de motivations inconscientes. Comme tout le monde, les patients psychiatriques ont sûrement des raisons inconscientes de se conduire comme ils le font. Mais faire de la thérapie ne signifie pas faire la recherche des causes du comportement humain. Même si un client connaît la raison inconsciente de chaque geste qu'il pose, il ne change pas nécessairement son comportement, tout simplement parce que le fait de connaître les causes ne le conduit pas à la satisfaction de ses besoins. En somme, mettre l'accent sur l'inconscient éloigne le patient de son irresponsabilité et lui donne une autre bonne excuse pour éviter de faire face à la réalité. (…)
Glasser croit que pour faire cesser un comportement insatisfaisant, le malade doit pouvoir satisfaire ses besoins de façon réaliste et responsable. Pour y arriver, le patient doit faire face au monde réel qui l'entoure, et ce monde inclut des normes de comportement. Le rôle du thérapeute est de confronter les comportements du patient à ces normes et de lui faire juger la qualité de ce qu'il fait. Si les patients psychiatriques ne jugent pas leur propre comportement, ils ne changeront pas.
"Le Dr. Glasser est aussi renommé pour avoir utilisé ses théories afin d'influencer une plus large part de nos sphères sociales comme l'éducation, le management, le mariage, et récemment pour la promotion de la santé mentale comme enjeux de santé publique, pour en nommer quelques-unes. En dernier lieu, mais non le moindre, il a été notable pour avoir averti le public en général à propos de sa profession et des dangers inhérents à celle-ci." (https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Glasser)
13/05/2016
Les technosciences et l'homme amélioré

La révolution technologique que nous sommes en train de vivre consiste aussi à poser à la société des questions sur la condition biologique et sociale de l’homme, et à permettre des transformations dont le but serait d’améliorer ou d’augmenter l’humain. Le transhumanisme est une nouvelle idéologie née aux Etats-Unis. Elle est soutenue par les quatre entreprises géantes Google, Apple, Facebook, Amazon (les GAFA) qui investissent des fortunes colossales dans des projets plus ou moins futuristes. « Ceux qui décident de rester humains et refusent de s’améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur », remarque le professeur de cybernétique Kevin Warwick. Lors d’une conférence à Vancouver en 2014, le chef de file du mouvement transhumaniste, Raymond Kurzweil, affirmait que l’homme pourra télécharger son cerveau dans un ordinateur environ en 2030. Il sera donc possible d’augmenter les capacités de l’homme et de le faire vivre le plus longtemps possible en bonne santé, avec l’aide des nouvelles technologies, des prothèses, des organes artificiels, de la thérapie génique. Telle une autre évangélisation, le transhumanisme se propage –en France il existe depuis peu (octobre 2015) une association (AFT-Technoprog) et un partenariat entre l’Université de la singularité, le Télécom Paris Tech et le Crédit Agricole dont l’objectif est de recruter l’élite et de la former aux nouvelles technologies (après la France, l’Afrique francophone).
16:24 Publié dans Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Cours/Courses, Formation/Training, Ingénierie/Engineering, Littérature, Livre, Management/Marketing, Public ciblé/Targets, Science, Web | Tags : transhumanisme, idéologie, technosciences, gafa, wittgenstein, émotion, art | Lien permanent | Commentaires (0)
22/02/2016
Pilule de sagesse (Le Réveil)

Les vitres extérieures du tram à Nice affichent une publicité qui invite à la réflexion : « To care for yourself is to care for others ». C’est, en quelque sorte, ce que développe cet article d’auteur inconnu mis en ligne par le site Wisdompills, et dont je propose la version plus loin.
08:07 Publié dans Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Web | Tags : sagesse, réveil, prendre conscience, vie | Lien permanent | Commentaires (0)
07/02/2016
"Les idéologies portatives"

« Tout ce que le philosophe peut faire, c’est détruire les idoles. Et cela ne signifie pas en forger de nouvelles. » C’est avec cette citation de Wittgenstein que s’ouvre l’essai intitulé Le bluff éthique, Editions Flammarion, 2008, de Frédéric Schiffter. L’auteur se propose de démystifier « les blablas » éthiques, celles qui, tout comme les blablas métaphysiques offrent aux hommes des recettes « vagues, sibyllines, ronflantes, lénifiantes, et, parfois, suffisamment bien tournées pour les bluffer, les impressionner en leur laissant le sentiment d’entrevoir quelque chose de fondamental quant à leur prétendu être » (….), celles qui leur promettent parfois « une humanité digne, heureuse, authentique, à laquelle, moyennant un « travail » sur eux-mêmes, ils auraient le droit et le devoir d’accéder ». « Nul, parmi les humains, ne croit que l’un d’entre eux, fût-il le plus avisé, détient le savoir de la vie meilleure, heureuse, joyeuse, ou plus humaine, et les règles qu’il conviendrait de se prescrire pour y atteindre, mais nul ne veut l’admettre.(…) Or, c’est bien parce que la science objective et raisonnable de la vie heureuse n’existe pas, que circulent les croyances éthiques soutenues avec plus ou moins de force persuasive par des discours verbeux auxquels les humains, toujours déçus, aiment à donner valeur de savoir mais sans jamais y croire. Cette mauvaise foi éthique ou, si l’on préfère, cette impossibilité de croire en quelque chose qui conduirait à une vie supérieure, s’explique par le fait que les humains suivent, « entre le naître et le mourir », dixit Montaigne, un parcours semé d’impondérables. Sachant, donc, pour en vivre l’expérience à chaque instant, que rien ne leur est assuré, tôt ou tard, que le néant, nulle proposition éthique ne les convainc bien longtemps. Selon les circonstances ou les périodes de leur existence, la vertu aristotélicienne peut les séduire autant que le souverain bien épicurien, l’impassibilité stoïcienne, le détachement bouddhiste, l’engagement sartrien, l’altruisme levinassien, l’humanitarisme bénévole. S’accrochent-ils pour un temps, même avec ferveur, à l’un de ces projets ou de ces idéaux, ils peuvent très facilement s’en déprendre ou les renier pour un épouser un autre. Les fins éthiques, ni plus ni moins que les autres croyances, ne supposent en rien la fidélité de leurs adeptes. » Si les humains peuvent comprendre intellectuellement que le bonheur, la justice, la vertu, etc.., ne sont que des fictions verbales (des « jeux de langage » comme dit Wittgenstein), il leur est impossible psychologiquement de supprimer en eux le désir d’y croire, et cela parce qu’ils sont également enclins à la crainte comme à l’espérance, les deux ressorts affectifs de l’éthique. En d’autres mots, il faudrait qu’ils n’aient plus la certitude effrayante de mourir. « Vivant ici ou là, sous tel ou tel climat, dans telles ou telles formes sociales changeantes, à telle ou telle époque, à la surface d’une planète fragile flottant dans une région perdue de l’espace infini en perpétuelle mutation, et, enfin, destinés, comme tout ce qui les entoure, à mourir, les humains savent bien qu’ils ne vivent pas dans un monde, que la somme de leurs passions ne fait pas l’Homme et que nul logos divin ou cosmique n’ordonna, n’ordonne et n’ordonnera jamais le réel. Seulement, ce savoir intuitif, charnel même, que Miguel de Unamuno appelait « le sentiment tragique de la vie », est une douleur. Refoulé chez le plus grand nombre, il génère un pessimisme malheureux consistant à déplorer que le monde soit « mal fait » -toujours inadéquat à ce qu’on attend-, contraire à un pessimisme heureux, cultivé, quant à lui, par un petit nombre, consistant à s’arranger de l’évidence que, n’étant « ni fait ni à faire », le « monde » n’a pas vocation à satisfaire les désirs humains. Or, c’est du pessimisme malheureux, du sentiment que le monde est mal fait, que surgit le désir optimiste de l’améliorer, de le modifier, de le transformer soit dans l’ensemble, soit dans le détail, à commencer par les humains (…) Les humains ressentent-ils le dérisoire de leur présence au sein d’un univers où les étoiles meurent comme des mouches ? Font-ils l’expérience du chaos, du choc des passions, de l’incompatibilité des névroses, de leur goût du carnage, du temps qui les ravage, de leurs plaisirs vite épuisés, de l’ennui, de l’esseulement, de l’incommunicabilité de leurs désirs, de la dépression, de l’échec, de l’usure, de la maladie, de la déchéance, de la mort qui les guette en embuscade ? C’est bien sûr à cet insoutenable sentiment du rien que disent remédier les notions lénifiantes de "monde ", de "nature ", d’ "être", d’ "harmonie", de "spiritualité", d’ "amour", de "liberté", de "vertu", d’ "amitié", de "justice", de "paix", de "raison", de "bonne volonté", de "bonheur", de "béatitude", de "réalisation de soi", de "sagesse", d’ "altruisme" , d’ "engagement", etc. ».
13:09 Publié dans Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Cours/Courses, Formation/Training, Ingénierie/Engineering, Littérature, Livre, Management/Marketing, Public ciblé/Targets, Science, Web | Tags : éthique, essai, philosophie, sagesses, recettes, littérature, art | Lien permanent | Commentaires (0)