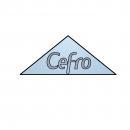17/07/2017
Le TSPT

L’altération des souvenirs factuels et émotionnels des traumatismes est au premier rang des recherches et des technologies en cours dans le domaine des sciences de la mémoire, note l’écrivain Wendy Walker dans une note à la fin de son roman Tout n’est pas perdu (All is not forgotten). Des scientifiques ont réussi à altérer des souvenirs factuels et à atténuer leur impact grâce aux médicaments et aux thérapies décrits dans ce livre, et ils continuent de chercher la drogue qui les ciblera et les effacera complètement. Si l’intention originale des traitements qui altèrent la mémoire était de soigner les soldats sur le terrain et d’atténuer les manifestations du TSPT, leur utilisation dans le monde civil a déjà commencé –et elle sera probablement extrêmement controversée.
Le psychiatre (qui est le narrateur dans le roman) offre au lecteur d’intéressantes explications sur le fonctionnement de la mémoire et sur les nouveaux traitements du syndrome post-traumatique. Dans une note précédente publiée sur ce site, on trouvera quelques références sur les faux souvenirs et sur les blessures émotionnelles. Mais parce que souvent le biais de la littérature est meilleur professeur, j’ai réuni des extraits du roman de Wendy Walker dans un document qui peut être lu ICI.
18:10 Publié dans Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Littérature, Livre, Science | Tags : livre, littérature, psychologie, mémoire, trouble du syndrome post-traumatique | Lien permanent | Commentaires (0)
25/03/2017
Nos émotions sont nécessaires
(Photo- Edisto Beach, Caroline du Sud, juillet 2016)
Une grande part de l’expérience émotionnelle humaine consiste à exprimer des émotions, positives ou négatives. Dans des circonstances similaires, certains restent calmes et aimables, d’autres peuvent élever la voix, ou avoir une réaction agressive. Néanmoins, les personnes un peu directes, même si elles sont désagréables, s’avèrent très efficaces. Cette agilité psychologique favorise une approche plus effective. Il est fort possible que nous évitions une telle stratégie parce que nous considérons que ce n’est pas bien d’être négatif. Nous pensons que les personnes agressives ou désagréables ne sont pas des gens bien, et nous ne voulons pas en faire partie. La bonne nouvelle est que tout un panel de la négativité -de la bonne négativité- n’a rien à voir avec être un pauvre type. Les émotions négatives peuvent nous aider à gérer une situation. Parfois, l’anxiété et le risque calculé mènent à la solution souhaitée. Les recherches ont montré que les personnes d’humeur plutôt dépressive avaient tendance à observer davantage de détails. Surtout quand il s’agit de déchiffrer les expressions faciales, les moindres changements dans le comportement sont observés, des choses que nous ne remarquons pas si nous sommes de bonne humeur. Personnellement, je sais que parfois l’effort d’être aimable, au lieu de rester juste neutre, factuelle, m’empêche de concentrer entièrement mon attention sur tous les éléments d’une situation précise.
19/01/2017
Le récit, c'est la vie

(Photo-Paul Klee, Fleurs dans la vallée)
Freud s’est intéressé à la catégorie des rêves attribués par les romanciers à leurs personnages imaginaires. Après avoir lu, en 1906, la très longue nouvelle Gradiva, fantaisie pompéienne par Wilhelm Jensen, il a publié l’analyse du récit sous le titre Le délire et les rêves dans la « Gradiva » de W.Jensen, un texte qui a fait couler beaucoup d’encre (d’ailleurs, le texte de la nouvelle et le texte psychanalytique de Freud sont toujours édités ensemble). En mettant en valeur les buts communs de la littérature et de la psychanalyse, il essaie de montrer l’importance des rêves dans la psychanalyse. Il compare la notion de refoulement à l’archéologie qui restitue le passé lors des fouilles.
A propos du héros de la nouvelle de Jensen, Freud écrit: « Une telle séparation de l’imagination d’avec la pensée raisonnante le destinait à devenir poète ou névropathe ; il était de ces êtres dont le royaume n’est pas de ce monde. Mais notre héros, Norbert Hanold, étant une pure création du romancier, nous voudrions adresser à celui-ci timidement cette question : son imagination a-t-elle été soumise à d’autres forces que le propre arbitraire de celle-ci ? » On sait que Freud a essayé de rencontrer le romancier, de le recevoir en analyse, mais Jensen s’est limité à répondre poliment à ses lettres. Entre le romancier et le psychanalyste qui mettait les bases d'une théorie sur le refoulement et les rêves, le malentendu est évident : Freud prêtait à l’auteur des intentions que celui-ci ne se reconnaissait pas, du moins consciemment. En réponse aux sollicitations insistantes du psychanalyste, Jensen tranche, dans une dernière lettre : « Non, je n’ai pas eu de sœur, ni d’une manière générale de parents consanguins. » Sa nouvelle provenait essentiellement d’une « motivation littéraire », et ses œuvres relevaient entièrement d’une « libre invention ». Evidemment, Freud ne veut pas entendre que le processus de création ne s’interprète pas comme un symptôme, et Jensen, qui n’est pas psychanalyste, ne le suivra pas sur ce terrain-là.
17:52 Publié dans Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Cours/Courses, Formation/Training, Littérature, Livre, Public ciblé/Targets, Science | Tags : freud, bruner, white, narration, psychologie | Lien permanent | Commentaires (0)
04/01/2017
Les thérapies brèves (II) L'approche narrative

(Photo-Bonne année 2017!)
La thérapie narrative, qui fait partie des thérapies brèves de troisième vague, est une approche ouverte initialement développée par des travailleurs sociaux et des thérapeutes (les co-créateurs de l'approche narrative sont Michael White et David Epston). La thérapie narrative est devenue « pratiques narratives » au fur et à mesure qu’elle investissait de nouveaux champs d’action tels que le coaching en entreprise. Selon Michael White, le travail thérapeutique consiste essentiellement à redévelopper des narrations personnelles et à reconstruire l'identité. Le principe de l’approche narrative est de découvrir quelles sont les histoires qui nous constituent et de dégager celle qui domine et nous retient prisonniers dans un schéma comportemental. Ces histoires donnent du sens à ce que nous vivons. Nous les construisons à partir de nos croyances, qui proviennent de notre culture, famille, éducation, religion, et elles sont déterminantes dans notre comportement face aux difficultés et aux choix que nous faisons.
15:03 Publié dans Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Cours/Courses, Formation/Training, Ingénierie/Engineering, Littérature, Livre, Management/Marketing, Public ciblé/Targets, Science, Web | Tags : activité erasmus+, techniques et pratiques narratives, psychologie, thérapie, histoires | Lien permanent | Commentaires (0)