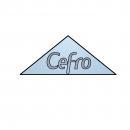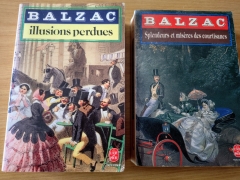01/02/2025
L'Imposture
(Photo- "Illusions perdues" et "Splendeurs et misères des courtisanes", deux piliers de la Comédie humaine de Balzac)
Une simple recherche nous dirige vers cette définition de l’imposture: action de tromper par de fausses apparences et des allégations mensongères, dans sa conduite, dans ses mœurs, notamment en usurpant une qualité, un titre, une identité ou en présentant une œuvre pour ce qu’elle n’est pas. Se faire passer pour ce qu’on n’est pas par une parole, un acte ou une manœuvre qui vise à tromper une personne afin d’en tirer profit. Au sens figuré, illusion: l’imposture des sens. Le terme est souvent utilisé pour désigner des doctrines destinées à séduire les hommes, mais également pour désigner certains ouvrages fabriqués dans une intention de fraude et donnés comme l’œuvre de quelque auteur connu. Du latin classique imponere (le terme veut dire porter une charge, imposer un tribut, et il a pris une connotation de tromperie) et du bas latin impostura. Synonymes : fausseté, duplicité, tromperie, mensonge.
Certains individus font preuve d’un comportement étonnant en recourant à l’imposture parfois tout au long de leur vie, sans qu’une motivation tangible puisse être discernée. Le ressort psychologique de l’imposture se trouve bien évidemment dans la structure du sujet et il est lié à l’identité et au mensonge, les deux impliqués dans le phénomène. Rappelons les définitions qu'en donne le Dictionnaire de psychologie:
« Relative à la conception que chaque société élabore de l’identité humaine, ethnique et culturelle, l’identité personnelle résulte de l’expérience propre à un sujet de se sentir exister et reconnu par autrui en tant qu’être singulier mais identique, dans sa réalité physique, psychique et sociale. L’identité personnelle est une construction dynamique de l’unité de la conscience de soi au travers de relations intersubjectives, des communications langagières et des expériences sociales. C’est un processus actif, affectif et cognitif, de représentation de soi dans son entourage associé à un sentiment subjectif de sa permanence. Ce qui permet de percevoir sa vie comme une expérience qui a une continuité et une unité et d’agir en conséquence. L’identité personnelle prend part dans une lignée. L’identité sociale résulte d’un processus de positionnement dans l’environnement: la participation à des groupes ou à des institutions. Elle peut être octroyée ou revendiquée en fonction des modalités d’affirmation de soi et du désir d’accomplissement. Sa construction et ses caractéristiques sont donc relatives, interactives et fonctionnelles. »
« Le mensonge est l’objet d’une conduite généralement verbale produisant des assertions contraires à ce qui est réputé vrai. Pour les moralistes, le mensonge implique l’intention de tromper. Il s’agit donc d’une conduite extrêmement complexe, qui suppose chez le locuteur un développement du langage suffisant pour entraîner la croyance de l’auditeur, l’élaboration des concepts de vérité et d’erreur, la mise en place de stratégies sociales à long terme. Le mensonge peut cependant être mis en œuvre « en catastrophe » pour résoudre à très court terme une situation conflictuelle insoutenable ». Néanmoins, il faut noter que « la conduite du mensonge implique la reconnaissance du secret, de la subjectivité et de la dissociation entre la conduite représentée et la conduite exprimée ou agie. Le mensonge en ce sens exprime le plus haut niveau de la prise de conscience. »
La psychopathologie de l’imposture a intéressé depuis longtemps les spécialistes du comportement humain, tel qu’il apparaît dans le monde réel ou dans des récits, des témoignages, des histoires. La littérature et la philosophie fournissent de nombreux exemples. Le fonctionnement psychique de l’imposteur qui met en scène une tromperie à usage collectif, qui sait tirer profit du semblant sur lequel se construit son discours même, avait déjà suscité l’attention de Freud et des premiers analystes. L’imposteur est celui qui abuse de l’apparence et impose l’image qui va rendre la victime de l’imposture fatalement solidaire de son acteur. L’imposture trouve toujours preneur, ce qui fait que l’on assiste à une double tromperie. Escroquerie, faux-self, simulation, et surtout discours habile, convaincant. Le comble de la manipulation est atteint dans les escroqueries, car la communication élaborée par quelqu'un peut « construire » pour un autre une situation différente de celle dans laquelle il se trouvait au début de cette situation de communication. Le principe à la base de l’escroquerie est que, pour changer le comportement des autres, il faut construire, pour eux, des situations dans lesquelles ce que l’on veut leur faire faire ou faire croire prend un sens positif.
Lorsque les destinataires séduits se réveillent, ils ne savent pas s’ils ont été piégés par l’imposteur, en tant qu’acteur, ou par son discours. Cela s’explique aussi par le désir social, qui aime un beau trucage, l’énergie des belles paroles. On peut donc parler d’une rhétorique de l’imposture. Et où serait la rhétorique de l’imposture plus présente sinon en religion et en politique ?
En examinant l’imposture sous un angle psychanalytique, l’article de revue L’imposture héroïque. L’art du semblant, paru dans Cliniques méditerranéennes (2010) rappelle que Freud voit chez le héros un genre d’imposture, car c’est le héros qui tue, or il s’agit du meurtre collectif originaire. L’article envoie aussi au Traité des trois imposteurs, c’est-à-dire les fondateurs des trois religions révélées. Il s’agit d’un texte qui a connu un succès extraordinaire tout au long du XVIII e siècle, et qui avait été recopié à la main de nombreuses fois. Selon le mystérieux auteur du texte, toutes les religions sont des fables entretenues par des imposteurs de mèche avec le pouvoir politique pour tyranniser le peuple. Le texte date de la fin du XVIIe siècle et il s’inspire des archives de Spinoza conservées aux Pays-Bas après la mort du philosophe (d’ailleurs, aujourd'hui il est édité sous la catégorie L’Esprit de Spinoza).
Le Traité commence ainsi :
« Quoiqu'il importe à tous les hommes de connaître la vérité, il y en a très peu cependant qui jouissent de cet avantage: les uns sont incapables de la rechercher par eux-mêmes, les autres ne veulent pas s’en donner la peine. Il ne faut donc pas s’étonner si le monde est rempli d’opinions vaines et ridicules; rien n’est plus capable de leur donner cours que l’ignorance; c’est là l’unique force des fausses idées que l’on a de la Divinité, de l’Ame, des Esprits et de presque tous les autres objets qui composent la Religion. (…) Ce qui rend le mal sans remède, c’est qu’après avoir établi les fausses idées qu’on a de Dieu, on n’oublie rien pour engager le peuple à les croire, sans lui permettre de les examiner; au contraire on lui donne de l’aversion pour les Philosophes ou les véritables Savants, de peur que la raison qu’ils enseignent ne lui fasse connaître les erreurs où il est plongé. Les partisans de ces absurdités ont si bien réussi, qu’il est dangereux de les combattre. (…) Si le peuple pouvait comprendre en quel abyme l’ignorance le jette, il secouerait bientôt le joug de ces indignes conducteurs, car il est impossible de laisser agir la raison sans qu’elle découvre la vérité. (…) On n’a besoin que d’un peu de bon sens pour juger que Dieu n’est ni colère ni jaloux; que la justice et la miséricorde sont de faux titres qu’on lui attribue; et que ce que les Prophètes et les Apôtres en ont dit, ne nous apprend ni sa nature ni son essence. »
(Paul Henry Thiry, Baron d’Holbach (1723-1789), Traité des trois imposteurs)
Ce texte, qui était méconnu du grand public, montre qu’il existait bien avant l’Europe des Lumières un puissant courant libertaire (qui allait aboutir à la Révolution française). Il redevient actuel à notre époque, en ce XXIe siècle où les plus hautes performances technologiques coexistent avec le prosélytisme religieux et l’enfermement communautaire, avec les conflits religieux et leurs attentats.
A propos de l’extraordinaire siècle des Lumières, voici un livre qui vient de paraître (Après Dieu) et qui nous fait redécouvrir l’esprit de Voltaire au travers d’un dialogue imaginaire que l’auteur, Richard Malka, défenseur de la liberté d’expression et du journal Charlie Hebdo, porte au Panthéon avec François-Marie Arouet. L’auteur le dédie « A tous ceux qui ont été tués au nom de Dieu. Pour un juron, une prière oubliée, un adultère, une apostasie ou un rire. A mes amis surtout. Ils riaient beaucoup, ne priaient jamais, étaient peu fidèles, totalement apostats et ils riaient avec ferveur. »
Quelques extraits de ce livre qui me semble offrir aussi une bonne description de la religion comme imposture sociale pourront être lus dans ce document PDF.
Ressources
Dictionnaire de psychologie
Dictionnaire Larousse
Cliniques méditerranéennes, 2010/81
La manipulation dans l’escroquerie (dans l’ouvrage Influencer, persuader, motiver, Alex Mucchielli, Editions Armand Colin, 2009)
Richard Malka, Après Dieu, Editions Stock, 2025
Et aussi les Archives CEFRO sur la conscience
http://www.cefro.pro/archive/2022/09/26/l-emprise-psychol...
http://www.cefro.pro/archive/2015/05/31/la-pensee-positiv...
http://www.cefro.pro/archive/2019/11/28/notre-part-d-ombr...
08:29 Publié dans Archives, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Littérature, Livre, Philosophie/Psychologie, Public ciblé/Targets, Science | Tags : imposture, imposteur, livre, psychologie, religion | Lien permanent | Commentaires (2)
01/11/2023
Archives CEFRO. Hubert Reeves/Livre
(Photo- Des campanules)
L'astrophysicien Hubert REEVES nous a quittés en octobre dernier, à l'âge de 91 ans. En 2021, j'ai publié une note pour présenter l'un de ses plus beaux livres, Malicorne (le nom d'un village en France), écrit en 1990 et dédié "à ceux qui sont épris de science et de poésie". Revoici cette note, où, comme souvent, je laisse parler le texte le plus possible.
http://www.cefro.pro/archive/2021/03/29/hubert-reeves-liv...
08:27 Publié dans Archives, Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Littérature, Livre, Philosophie/Psychologie, Science | Tags : hubert reeves, livre, science, univers, religion | Lien permanent | Commentaires (0)
01/02/2023
Lire Spinoza, une forme de thérapie

(Photo- L'hiver, ailleurs)
Le mal est une absence de bien (privatio boni). C’est ce que dit Thomas d'Aquin, philosophe et théologien, l’un des pionniers de la Scolastique au 13 e siècle, Docteur de l’Eglise, le plus saint des savants et le plus savant des saints. Thomas d'Aquin occupe un chapitre dans mon travail de Thèse sur la pensée et la littérature du Moyen Âge, et, des années plus tard, quand mon intérêt allait s'élargir au domaine des émotions et des neurosciences, sa formule concise privatio boni, comme définition du mal, m'est apparue sous un autre éclairage. Par exemple, à propos de l’absence de joie, même dans les moindres aspects de la vie (ce que l’on appelle anhédonie ou perte de la capacité à éprouver du plaisir - symptôme central de la dépression majeure et de certains troubles neuropsychiatriques).
Mais plus concrètement, comment faire quand on se trouve confronté au mal absolu, c'est-à-dire à la mort, violente et soudaine, d’un être cher ? En général, il existe deux solutions censées apporter un peu de consolation : la religion (la foi) et la philosophie (la raison). C’est pourquoi, depuis novembre dernier, je me suis plongée dans la lecture de mon philosophe-thérapeute, Spinoza, qui m'avait déjà aidée en 2003, dans un moment difficile.
Ceux qui connaissent Spinoza savent qu’il était loin d’être athée (bien qu’il fût excommunié), et qu’il a créé peut-être le plus cohérent des systèmes philosophiques, où la Raison et la Joie occupent une place fondamentale: Deus sive Natura. Il explique, dans son Traité de la réforme de l’entendement, le but de sa recherche : "Je résolus de chercher s’il existait quelque objet qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l’âme, renonçant à tout autre, pût être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine". Ce Bien suprême est Dieu, mais c'est le Dieu de Spinoza.
Cette fois-ci, j'ai choisi le Traité théologico-politique. J’ai résumé quelques idées dans ce document PDF.
Références
Spinoza, Œuvres II. Traité Théologico-politique, GF-Flammarion, 1965
08:00 Publié dans Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Livre, Philosophie/Psychologie, Science | Tags : spinoza, religion, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0)
01/11/2021
Ethique et religion?
(Photo- L'automne au bord du Danube, Galatzi)
Wittgenstein avait présenté sa Conférence sur l’éthique devant un public de non-philosophes. Selon lui, l'éthique se pense toujours dans un contexte et dans des pratiques déterminées, elle ne saurait être une théorie, mais aurait un caractère intrinsèquement personnel. L'analyse détaillée des aspects physiques et psychologiques de nos actions ne nous révélera jamais ce qui les lie à l'éthique, mais c'est notre attitude vis-à-vis de ces actions qui les rend éthiques, plus exactement la manière dont nous arrivons à nous extraire des faits pour les contempler comme d'un point de vue extérieur. Il dit, par exemple, que lorsque quelqu'un face à une décision importante se demande "Que dois-je faire?", le sérieux de cette question est "éthique" parce qu'il se distingue d'autres types de choix. Donc, l'éthique est dans l'attitude du sujet qui expérimente et qui éprouve. Le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux, bien que les faits qui le constituent soient identiques, c'est le regard qui change, la volonté à l'égard de ce monde qui est différente, mais pas le monde lui-même. En voulant exprimer l'inexprimable (tout comme la religion ou l'esthétique), l'éthique se confronte aux limites du langage, elle ne peut pas s'énoncer sous la forme de propositions douées de sens, mais elle peut se montrer à travers des expériences qui la révèlent dans son authenticité. Wittgenstein ne méprise pas les polars, cette littérature "mineure" où il dit trouver des exemples d'expériences éthiques souvent plus profondes que celles présentes dans les ouvrages de philosophie.
Il y a dix ans, lors de l’affaire DSK, France 3 a diffusé un documentaire (DSK, l’homme qui voulait tout), réalisé par un psychanalyste très médiatique et aussi très à gauche, et dont l’intention affirmée était de proposer un regard freudien. Je n'avais regardé qu’un quart d’heure de ce documentaire, pas plus. Un regard freudien signifie pour moi quelque chose d'implacable et de sentencieux, je ne m'attendais donc pas que le documentaire fût joyeux, mais la démarche allait subtilement dans le sens d'une justification finalement logique (et que j'avais trouvée assez politique). C'est toujours Wittgenstein qui écrit, à une époque où il n'admirait plus la psychanalyse, que "les pseudo-explications fantastiques de Freud (justement parce qu'elles sont pleines d'esprit) ont rendu un mauvais service, n'importe quel âne disposant maintenant de ces images freudiennes pour "expliquer" avec leur aide des symptômes pathologiques" (dans Remarques mêlées).
Pour Thomas d'Aquin, le mal est une absence de bien, privatio boni, il dérive d'une perversion du bien. Nous faisons le mal parce que nous désirons le bien, et nous recherchons le bien de mauvaise façon. Le désir qui s'oriente vers le mal ne peut être qu'une perversion du désir, et celui qui convoite le mal le fait à cause d'un défaut, d'un manque dans sa capacité de désirer, une sorte d'infirmité. Pourquoi le mal serait-il donc nécessaire? D'abord, à cause de la constitution de l'homme comme créature, ensuite pour mettre mieux en évidence le bien. Si chaque objet est connu par rapport à son contraire, alors, s'il n'y avait pas de mal, le bien serait connu de façon moins déterminée, et par conséquent serait désiré avec moins d'ardeur. Si le bien doit être reconnu avant d'être désiré, il peut être reconnu avec plus de précision en étant mis en rapport avec le mal. En ce sens, le mal devient une occasion de bien. Jusqu'à la fin du XVIIIe, la poursuite du bonheur était quelque chose attaché au concept de bien, et aussi le ressort évident de toute action humaine. Pour les Stoïciens le bonheur ou le vrai bien découle directement de la vertu rationnelle -ne pas désirer, c'est être libre. L'adversité n'est pas dans les choses, mais dans le désir qui nous met en conflit avec les choses. C'est dans L'Ethique à Nicomaque que nous pouvons trouver une analyse rigoureuse du lien entre le bonheur et le souverain bien. En observant que "tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux", Aristote réfute toutes les positions visant à réduire le bonheur au plaisir, à la richesse, aux honneurs. Pour lui, le bonheur n'est jamais désirable en vue d'autre chose, il est toujours une activité menée conformément à la raison et en accord avec la vertu. En même temps, ce n'est que l'intellect qui délibère, car il permet non seulement d'expliquer une action, mais aussi de la justifier d'un point de vue éthique. D'où l'importance de la sagesse ou de la prudence, qui est pour lui "une disposition accompagnée de règle vraie, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bien ou mal pour les êtres humains" (Ethique à Nicomaque, 1143 B 3-4). L'activité propre de l'homme réside dans l'activité de l'âme conforme à la raison, c'est-à-dire à la vertu. C'est pour cette raison que bonheur et vertu sont identifiés: si l'homme réalise son excellence par la vertu, si c'est par elle qu'il atteint sa fin propre, alors c'est elle qui doit être qualifiée de souverain bien.
Pour Spinoza, qui recherche le Souverain Bien capable de se communiquer, le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, il est la vertu elle-même. Selon le philosophe, les religions doivent être tolérées mais soumises à la puissance publique.
« Les pratiques ferventes et religieuses devront se mettre en accord avec l’intérêt public, autrement dit si certaines de leurs expressions sont susceptibles de nuire au bien commun, il faudra les interdire. » « Je déclare l’homme d’autant plus en possession d’une pleine liberté qu’il se laisse guider par la raison. » (Traité théologico-politique, 1670). Un siècle avant Voltaire et Kant, Spinoza est le premier théoricien de la séparation des pouvoirs politique et religieux et le premier penseur moderne de nos démocraties libérales. Il n’est pas athée, bien sûr, mais il ne croit pas au Dieu révélé de la Bible. Pour lui, Dieu est un Etre infini, véritable principe de raison, de sagesse philosophique. Il propose un dépassement de toutes les religions par la sagesse philosophique qui conduit à l’amour intellectuel de Dieu, source de Joie et de Béatitude. Il souhaiterait que les lumières de la raison permettent aux humains de découvrir Dieu et ses lois sans le secours de la loi religieuse et de tous les dogmes qui l’accompagnent, qu’il considère comme des représentations puériles, sources de tous les abus de pouvoir possibles, la religion correspondant à un stade infantile de l'humanité.
La conception spinoziste de Dieu est totalement immanente: il n’y a pas un Dieu antérieur et extérieur au monde, qui a créé le monde (vision transcendante), mais de toute éternité, tout est en Dieu et Dieu est en tout à travers des attributs qui génèrent une infinité de modes singuliers, d’êtres, de choses, d’idées. Deus sive Natura. L’éthique immanente du bon et du mauvais remplace ainsi la morale transcendante et irrationnelle du bien et du mal. La Joie parfaite ou la Béatitude, est le fruit d’une connaissance à la fois rationnelle et intuitive qui s’épanouit dans un amour universel, fruit de l’esprit, un amour intellectuel de Dieu. Il y a trois genres de connaissances : l’opinion et l’imagination, qui nous maintiennent dans la servitude, la raison, qui nous permet de nous connaître et d’ordonner nos affects, et un troisième, en prolongement du deuxième, l’intuition, par laquelle nous arrivons à l’adéquation entre notre monde intérieur et le cosmos entier. « Plus on est capable de ce genre de connaissance, plus on est conscient de soi-même et de Dieu, c’est-à-dire plus on est parfait et heureux » (Ethique). Donc, union à un Dieu immanent par la raison et l’intuition. « L’homme vertueux n’est plus celui qui obéit à la loi morale et religieuse, mais celui qui discerne ce qui augmente sa puissance d’agir ». Et c'est justement la libération de la servitude qui augmente notre puissance d’agir et notre joie. Plus nos sentiments et nos émotions seront réglés par la raison, plus nos passions seront transformées en actions, plus grande sera la part de notre esprit qui subsistera à la destruction du corps. La liberté s’oppose à la contrainte, mais non à la nécessité. On est d’autant plus libres qu’on est moins contraints par les causes extérieures et qu’on comprend la nécessité des lois de la Nature qui nous déterminent.
On comprend pourquoi Nietzsche, qui n'aura de cesse de déconstruire les catégories morales transcendantes du bien et du mal établies par la morale chrétienne, puis par Kant, jubilera en découvrant la pensée de Spinoza: "Je suis très étonné, ravi! J'ai un précurseur, et quel précurseur!" (Frédéric Lenoir, Le Miracle Spinoza). Nietzsche fulmine contre l'Eglise chrétienne: "Elle est pour moi la plus haute des corruptions concevables (...), de chaque valeur elle a fait une non-valeur, de chaque vérité un mensonge, de chaque rectitude une bassesse." (Jacques Duquesne, Le Diable)
Références
Archives blogs
- De l’Ethique (2013) http://elargissement-ro.hautetfort.com/archive/2013/03/20...
- La Covid-19 (2020) http://elargissement-ro.hautetfort.com/archive/2020/03/11/le-covid-19.html
- Ethique et univers (2015) http://www.cefro.pro/archive/2015/02/13/ethique-et-univers.html
08:00 Publié dans Archives, Blog, Compétences émotionnelles/Emotional Intelligence, Conseil/Consultancy, Littérature, Livre, Public ciblé/Targets, Science | Tags : éthique, religion, philosophie, bonheur, vertu | Lien permanent | Commentaires (0)